Cobotique : risques et opportunités pour l'homme au travail

Une technologie prometteuse
Les robots industriels ont été longtemps séparés des opérateurs pour des raisons de sécurité. Les technologies évoluent et tendent à privilégier les robots collaboratifs qui travaillent sans risques, aux côtés des humains. Ces avancées impactent l'industrie mais également des secteurs non-industriels et domestiques. Moins coûteux que les robots industriels traditionnels, leur vocation est d’aider l’humain dans les tâches les plus pénibles en toute sécurité.
Il existe trois grands types de "cobots": les robots collaboratifs pilotés par un opérateur à proximité immédiate du système, les cobots commandés à distance et les exosquelettes (structures électromécaniques qui assistent l'opérateur dans son effort). Selon un article du Monde, daté du 25 mars 2018 et consacré à la modernisation de l'appareil de production français, les investissements dans les robots industriels ont augmenté de 30 % en 2017 (source : Symop).
Certains fabricants assurent un retour sur investissement inférieur à une année et des gains de productivité pouvant atteindre 35 %. L'International Federation of Robotics (IFR) dans son étude 2018 The impact of robots on productivity, employment and jobs estime que plus de 300 000 robots collaboratifs seront vendus entre 2016 et 2019. Cette évolution concernera les robots d'assistance au port de charges lourdes, les exosquelettes qui soutiennent les processus de production ainsi que la catégorie des véhicules automatisés qui devraient se développer à la fois dans les usines et les entrepôts mais également dans les hôpitaux.
Réduire la pénibilité… mais pas sans risques
Cette technologie n’est pas sans danger si la conception ergonomique est négligée. Deux défis se présentent : assurer la sécurité de l’opérateur et coordonner l’humain avec le cobot.
Cobot de micro-assemblage compact, instrument cobotique pour la laparoscopie, robot d’assistance et de désherbage mécanique pour les agriculteurs, harnais de manutention et lunette intelligentes (vision picking) dans la logistique, exosquelette sur une chaîne de montage, bras articulé pour l’assemblage ou le soudage dans l’automobile, robot assistant les soignants pour soulever les personnes, combinaison avec accoudoirs (exosquelettes) pour le peintre en bâtiment… le cobot se développe dans de multiples secteurs. Il allie à la fois précision du geste et réduction des contraintes liées à la répétition des tâches et à la manutention de charges lourdes. Il représente, par ailleurs, une opportunité d’assistance pour les salariés diminués ou vieillissants. La robotique collaborative participe ainsi à l’amélioration des conditions de travail en visant la réduction des TMS (troubles musculo-squelettiques).
Mais, le robot collaboratif reste, malgré tout, implanté dans l’environnement de travail de l’opérateur. Il introduit de nouveaux types de risques en santé et sécurité, même si peu d'études permettent d'avoir une idée précise des impacts des robots d'assistance physique comme le mentionne D.Baudier dans l'article du numéro d'avril 2018 de Hesamag : "Exosquelette : un atout contre la pénibilité ?".
Dans une synthèse de travaux réalisés à l'international intitulée « Prévention dans le domaine de la robotique collaborative », Eurogip fournit une liste de ces risques. Parmi les accidents du travail, il y a les collisions et les écrasements. La limitation ou la contrainte des mouvements de l’opérateur peut être source de troubles musculo-squelettiques (TMS). D’autres risques physiques sont liés à la cybersécurité et à la maintenance : reprogrammation malveillante, mauvais usage des commandes et des fonctionnalités du cobot, sécurisation défectueuse ou insuffisante lors de la maintenance. Les risques psychosociaux, également présents, trouvent leur origine dans différentes situations. Ainsi la vigilance permanente sur la machine, l’augmentation des cadences, la surcharge d’informations, la perte d’autonomie sont autant de facteurs de stress. Enfin, la manipulation des cobots n’est pas intuitive et nécessite une phase d’apprentissage pouvant aller jusqu’à plusieurs mois. La période d’appropriation est variable et doit être impérativement respectée.
Une technologie qui doit encore faire ses preuves
Les industriels ne semblent pas totalement convaincus des apports de la cobotique. C'est ce que montre l'INRS dans une enquête présentée en mars 2018 dans la revue "Hygiène et sécurité" : "Robotique collaborative : perception et attentes des industriels". Si la majorité des personnes interrogées estiment que la robotique collaborative peut améliorer la production et la flexibilité, seuls les industriels ayant déjà investi dans la cobotique y voient un impact positif sur la prévention des troubles musculo-squelettiques.
L'enquête permet d'identifier quelques freins à de potentiels investissements : l'augmentation des distances de sécurité ne permet pas la réduction des espaces de travail ; "la limitation des vitesses de déplacements ou la diminution de la charge utile" apparaissent insuffisantes ; "les arrêts ou les ralentissements intempestifs" (des cobots) peuvent entraîner des baisses de productivité.
L'Observatoire Fives cite, en 2015, dans sa publication : « Homme + robot, une équipe gagnante pour l'usine du futur ? » des innovations intéressantes amenées à se généraliser. Parmi elles, « les procédés de compensation de poids strict et d’augmentation d’effort appliqué : La compensation de poids strict consiste à équilibrer parfaitement la charge transportée à l’aide du robot. (...) Les efforts imprimés par l’opérateur sur la pièce ou sur une partie du robot permettent de manipuler facilement et légèrement la pièce selon 6 degrés de liberté, en translation et en rotations. Dans l’augmentation d’effort appliqué, l’effort de l’opérateur est mesuré et, grâce à une commande en effort adaptée, est décuplé par le robot. » L'étude cite plusieurs autres exemples concrets d'application et d'apports de la cobotique. D'autres recherches portent sur la limitation de la force des robots. Des capteurs sont ainsi conçus pour veiller à l’intensité des efforts et à limiter les collisions. Ces travaux s'intéressent également à la surveillance de l’environnement et à l'anticipation des interactions dangereuses.
Si la robotique collaborative reste source d'inquiétudes, elle tend actuellement à augmenter les capacités physiques de l'opérateur tout en assurant sa sécurité et en améliorant sa productivité.
Réussir l’interface homme-robot
En prenant en charge les tâches routinières et répétitives, la cobotique peut soulager les salariés et leur permettre d’accéder à des tâches plus valorisantes. Pour être efficientes, la mise en oeuvre de ces technologies doit associer l'opérateur.
C'est ce que recommande le do-tank Agora Industrie dans son rapport " Révolution humaine ? Un nouveau rôle pour les hommes et les femmes de l’industrie du futur ". Il souligne l'importance de "penser la conduite des processus avec des individus en parfaite harmonie avec les machines. Pour cela, travailler sur l’ergonomie des postes de travail dès la conception des chaînes de production peut s’avérer pertinent. »
Des normes internationales ont été élaborées (NF EN ISO 10218-1 et 2 : 2011) et complétées en 2016 par une spécification technique référencée ISO/TS 15066: 2016 dédiée aux applications collaboratives. Sur son site, l’ISO (Organisation internationale de normalisation) précise : "Cette nouvelle spécification technique ISO ouvre de nombreuses possibilités pour la robotique. En effet, elle contribuera à rassurer et à orienter à la fois les concepteurs et les utilisateurs des systèmes robotiques, en encourageant l’investissement dans ce domaine, de même que le développement et l’application de cette technologie."
Sur la co-activité homme-robot, le député Cédric Villani dans son rapport " Donner un sens à l'intelligence artificielle " remis au Premier Ministre le 28 mars 2018 précise que " la définition de ce mode de complémentarité doit faire l’objet d’un dialogue large, qui intègre en premier lieu les salariés. Il s’agira notamment de concilier la volonté de développer les marges de manoeuvre des individus et les effets potentiellement négatifs des injonctions à la créativité, qui peuvent être source de difficultés pour beaucoup d’individus." Il introduit ainsi la notion de complémentarité capacitante, estimant nécessaire son développement dans les organisations " pour que se dessine un optimum dans l’utilisation de l’intelligence artificielle en collaboration avec l’intelligence humaine ".La question des compétences et de l'évolution de l'automatisation des tâches est bien au coeur de la problématique "robotisation et emploi".
La robotique collaborative est amenée à se développer rapidement, notamment en France. Des actions en faveur de la robotique de service ont ainsi été lancées dans le cadre du Programme Nouvelle France Industrielle (NFI).
Parce qu’elle questionne l’organisation du travail, l'interaction homme-machine doit être envisagée de manière concertée entre l'opérateur, les responsables de projet et les préventeurs. Outre les objectifs de performance, les complémentarités doivent être un levier d’amélioration des conditions de travail
Organismes de référence
ANACT : Projet TN&T, financé par le Fond social européen (FSE) : Transformations numériques et travail, 2018-2019
AIF: L’Alliance Industrie du Futur organise et coordonne, au niveau national, les initiatives, projets et travaux tendant à moderniser et à transformer l’industrie en France.
Cea: Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergies alternatives
Cetim: Centre technique des industries mécaniques
Irstea : Institut national de recherche en sciences et technologies our l'environnement et l'agriculture
A voir
Robotique collaborative. Enjeux pour l'industrie et challenges techniques. Etats généraux de la robotique 2017. Innorobo. Yann Perrot, 15 mn.
Exosquelettes : des robots que l’on porte comme un vêtement et qui réduisent la pénibilité au travail. Europe matin, 16/11/2017.
Le commissariat à l'énergie atomique de Saclay (CEA) propose un exosquelette pour réaliser des travaux agricoles. Terre-net, 01/02/2017.
Ressources

Robotique collaborative : perception et attentes des industriels
THAY, David
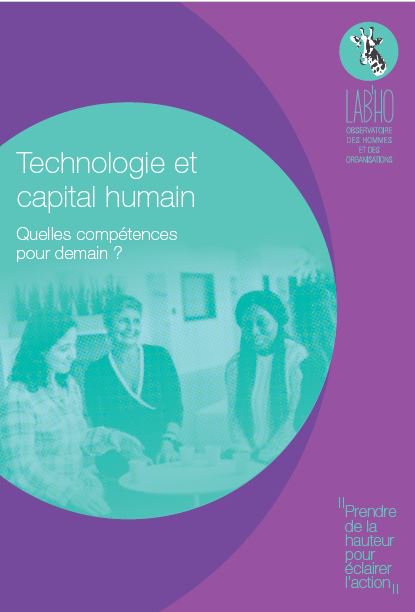
Technologie et capital humain : quelles compétences pour demain ?
AVEZAC DE MORAN, Tristan d'

Donner un sens à l'intelligence artificielle. Pour une stratégie nationale et européenne. Rapport au Premier Ministre
Villani, Cédric

Robotique collaborative. Evaluation des fonctions de sécurité et retour d'expérience des travailleurs, utilisateurs et intégrateurs au Québec
JOCELYN, Sabrina

Intelligence artificielle et travail
BENHAMOU, Salima
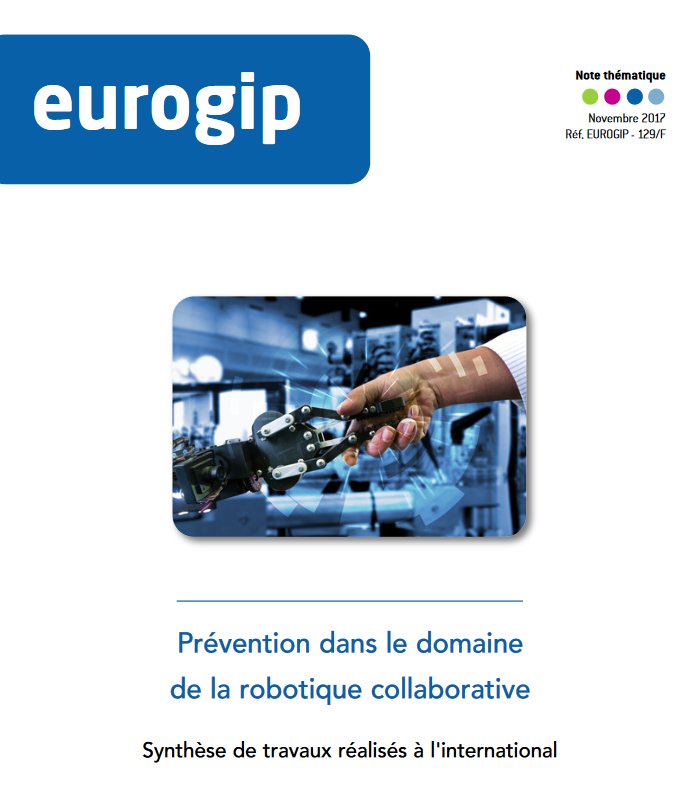
Prévention dans le domaine de la robotique collaborative. Synthèse de travaux réalisés à l'international
BELINGARD, Pierre

Exosquelettes : un atout contre la pénibilité ?
BAUDIER, Denis

Guide de prévention à destination des fabricants et des utilisateurs : pour la mise en oeuvre des applications collaboratives robotisées

Robotique collaborative : perception et attentes des industriels
THAY, David
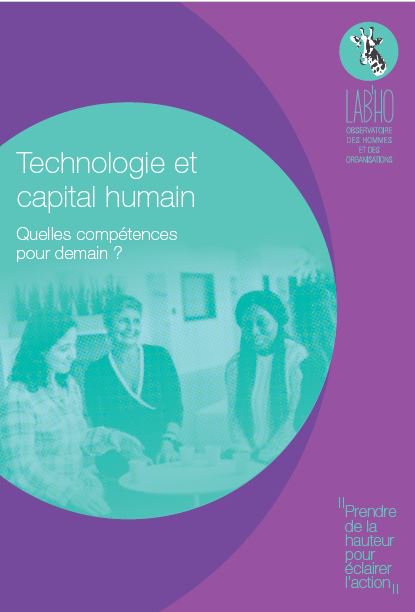
Technologie et capital humain : quelles compétences pour demain ?
AVEZAC DE MORAN, Tristan d'

Donner un sens à l'intelligence artificielle. Pour une stratégie nationale et européenne. Rapport au Premier Ministre
Villani, Cédric

Robotique collaborative. Evaluation des fonctions de sécurité et retour d'expérience des travailleurs, utilisateurs et intégrateurs au Québec
JOCELYN, Sabrina

Intelligence artificielle et travail
BENHAMOU, Salima
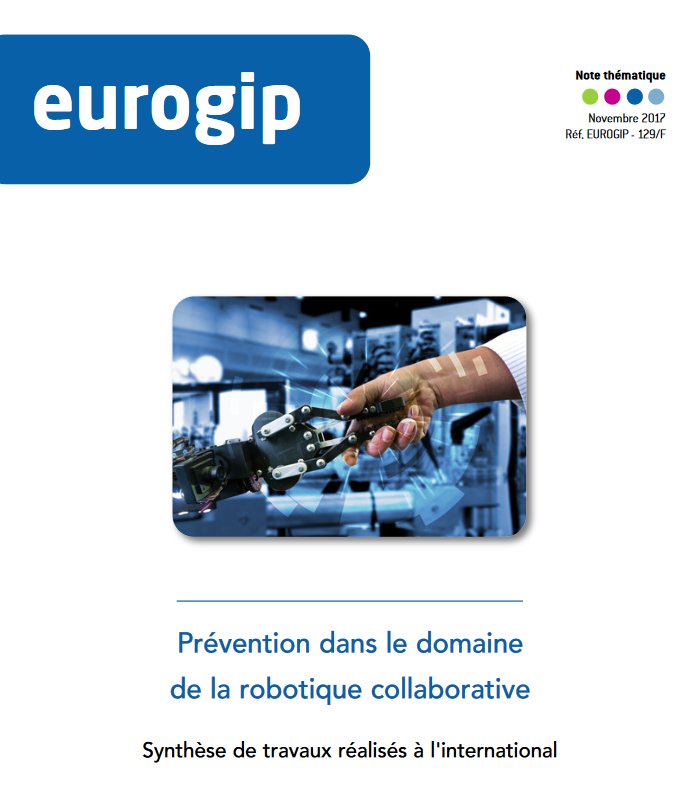
Prévention dans le domaine de la robotique collaborative. Synthèse de travaux réalisés à l'international
BELINGARD, Pierre

Exosquelettes : un atout contre la pénibilité ?
BAUDIER, Denis



